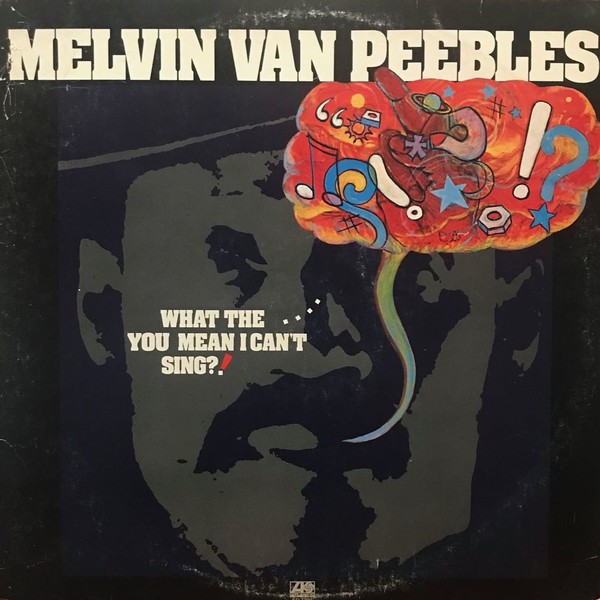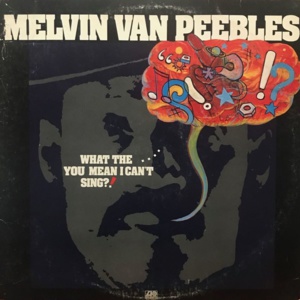Qui est Melvin Van Peebles ?
Je suis un « amerloque » mais j'ai passé pas mal de temps ici en France. Je suis allé dans pas mal de pays mais je suis souvent à Paris, à New York et quelques fois à Los Angeles. Ce sont mes trois endroits habituels.
Vous avez entamé la réalisation de films après une discussion avec un passant, à l'époque où vous étiez conducteur de tramway à San Francisco. C'est vrai cette histoire ?
C'est presque ça. J'ai fais un roman avec des photos sur la vie de quelqu'un qui conduit les « Cable cars » à San Francisco. A un moment donné un monsieur est venu me voir sur mon « Cable car » pour que je lui dédicace mon livre (« The big heart » 1957 NDLR) et m'a dit: « Vous savez, votre bouquin c'est comme un film. » Cela m'a donné l'idée de passer derrière la caméra. C'est ainsi que j'ai commencé à faire des courts-métrages. Je suis allé à Los Angeles. Là bas on m'a dit: « Monsieur on ne prend pas des gens de couleur pour faire des films. » Du coup je suis parti en Hollande pour continuer mes études d'astronomie. Quand j'étais plus jeune j'étais pilote de bombardier pour l'US Air Force. J'ai vécu un peu aux Pays-Bas et puis j'ai reçu une invitation de la Cinémathèque française. Henri Langlois de la Cinémathèque avait vu mes petits films. Les américains me disaient que ça ne valait rien. Mais pour la Cinémathèque j'étais un génie! Alors j'ai dis: « Bien sûr je suis d'accord avec vous! Je suis un génie! » C'est de cette façon que je me suis retrouvé en France en 1959.
De quoi parlent ces courts-métrages comme « Three pick up men for Herrick » réalisé en 1957 ?
Oula à mon âge je ne me souviens plus très bien de quoi ça parlait! Je me rappelle juste qu'il y a une séquence où des gens attendent dans un coin pour être engagés comme éboueurs à la journée. Quelque chose comme ça. J'ai aussi fait un court-métrage plus tard ici à Paris, en 1963, dans le quartier de Belleville: « Cinq cent balles » L'histoire d'un enfant qui essaie d'attraper un billet de cinq cent balles dans une grille d'égout.
Et puis en 1967 vous réalisez votre premier long-métrage, toujours en France adapté de votre propre roman: La Permission (The story of a three days pass)
Ce qui est amusant c'est que ce film a été choisi pour représenter la France au festival du film de San Francisco. Les gens du festival ne savaient pas que j'étais noir ni que j'étais d'origine américaine. Tout le monde était stupéfait! Mais ce film a vraiment enclenché ma carrière dans le cinéma. J'ai aussi écrit la musique de « La permission » J'avais là deux carrières qui commençaient en même temps: musique et cinéma.
« La permission » c'est une histoire d'amour entre une jeune française et un GI noir américain de passage à Paris. Qu'est ce qui vous a inspiré ce film?
Les histoires d'amour ça marche toujours... à l'écran. Quand j'étais en France il y avait des bases américaines. Je me suis dis que c'était un sujet intéressant à exploiter. Le mélange de tout ça.
Là où nous sommes, du côté de Pigalle, j'aperçois un exemplaire d'Hara-Kiri, journal dans lequel vous avez écrit. Racontez-moi votre expérience de journaliste.
J'étais dans le 14ème arrondissement de Paris et j'avais lu une histoire de meurtre dans le journal. Je ne croyais pas à l'histoire qui était publiée. Je me suis pointé au journal: France observateur (l'ancêtre du Nouvel observateur NDLR) C'était au mois d'août. Tous les « vrais journalistes » étaient partis en vacances. J'ai eu de la chance. Comme il n'y avait personne je me suis retrouvé à faire le reporter pour ce journal. Et puis j'ai entendu parler d'un nouveau journal de « conneries » qui s'appelait Hara-Kiri. C'est comme ça que je suis allé là bas et que j'ai travaillé avec Topor, Gébé, Wolinski, Cavanna (prononcé Cavanaugh avec l'accent américain) toute cette bande là. Je faisais des traductions de « Mad « (magazine satirique américain créé par William Gaines et Harvey Kurtzman en 1952 NDLR) pour Hara-Kiri, des choses comme ça.
Comment étiez-vous perçu en tant que noir américain dans la France des années 60 ?
Je ne me considérais pas comme un touriste ou un expatrié américain. J'avais la vie de monsieur, madame, du quidam français. Très souvent les américains faisaient comme ça. Au commencement j'étais clochard devant le Café Deux Magots, le Café de Flore... Petit à petit j'ai appris l'argot, avec d'autres clodos. Je chantais dans la rue pour gagner un peu d'argent. J'ai vraiment été baigné dans la façon dont vit un français pauvre à Paris.
En 1970, fort de « La permission » vous arrivez avec un film à plus gros budget, tourné aux Etats-Unis: « Watermelon man » L'histoire d'un agent d'assurances blanc qui se réveille un matin dans la peau d'un noir.
C'est le seul film que j'ai fait pour un grand studio: Columbia films. J'ai fait ce film pour gagner le pognon et la notoriété afin de faire une oeuvre indépendante. Avec les bénéfices de ce film commercial j'ai pu faire mon chouchou: « Sweetback »
Justement, « Sweet Sweetback's baadassss song », sorti un an après, c'est le premier film de la « Blaxploitation ». Comment a débuté cette aventure?
C'est le mot juste: aventure. Ce film s'est fait dix ans après que j'ai été viré des studios californiens où j'avais réalisé mes premiers-courts métrages. Il n'y avait toujours pas de gens de couleur au cinéma. Il y avait quelquefois des acteurs mais pas de scénaristes ou de réalisateurs noirs. Et bien moi j'ai fais les trois! Les types des studios me disaient: « Ta gueule », ne me prenaient pas au sérieux. Une fois que le film est sorti, ça a fait plus de pognon qu'aucun film indépendant auparavant! Et là je suis devenu subitement un grand héros pour ces types. On m'appelle le père de la Blaxploitation parce que quand j'ai fais le fric de « Sweetback », les gars des studios ont fait des films « soit-disant noirs ».
Les film qui ont suivi le succès de Sweetback: « Shaft », « Foxy Brown », « Black Caesar » etc ce sont des films « récupérés » par les major companies, pour vous?
Les studios m'ont mis à l'écart dès le début. « Sweetback », quand on le regarde attentivement c'est un film politique. Alors que les personnages noirs dans les films suivants sont des « bénis-oui oui ». Ils ont noyé le poisson dans ces films. Quand on regarde « Shaft » et les autres, on s'aperçoit qu'au dessus des réalisateurs ou acteurs noirs, il y a toujours un blanc qui les dirige. Mais pas chez moi! « Sweetback » est un film militant. Les « Black panthers » à la sortie, ont demandé que chaque membre des « Panthers » aillent voir le film.
Vous avez dû emprunter à l'acteur et showman Bill Cosby pour vous aider à financer le film?
Il est intervenu plus tard dans le processus. Cosby a été très charmant avec moi. Il est venu sur le tournage. J'avais besoin de fric pour terminé le film. Il m'a aidé. Comme j'avais travaillé pour lui une fois je lui ai demandé de me donner un coup de main. C'est ce qu'il a fait. J'ai remboursé ce qu'il m'a prêté et tout le reste je l'ai payé de ma poche.
Etre considéré comme le père des films « Blaxploitation » vous le voyez comment avec le recul?
Ce n'est pas uniquement un film « Blaxploitation ». Ce film a aussi fait beaucoup pour le cinéma indépendant. Cela ne s'était jamais vu avant un film indépendant qui fait autant de fric que le mien! Avant ce film les oeuvres indépendantes n'étaient pas mises dans le circuit d'exploitation. N'oubliez pas que ce fameux « Sweetback » il n'y avait que deux salles, je dis bien deux salles, même pas deux villes, dans tous les Etats-Unis, qui étaient d'accord pour le montrer! Comme le film a super bien marché dans ces deux salles, à ce moment là les faux culs m'ont appelé: « Oh Melvin! Melvin! » A part le prêt de Bill Cosby à la fin, j'ai vraiment tout produit. Et comme je n'avais pas assez d'argent pour payer des vrais musiciens c'est moi qui ai composé la musique du film. J'ai pris un groupe pour les jouer... c'était « Earth wind and fire ». Et c'était le premier album de leur vie!
Earth Wind and fire, groupe mythique de Chicago en étaient à leurs premiers pas. Comment les avez vous rencontrés?
Ma secrétaire de l'époque Priscilla était très proche de l'un des musiciens. Elle m'a demandé si j'étais d'accord d'écouter son Jules et son groupe. C'était un pur hasard. Je ne connaissait pas Earth Wind and fire. Je les ai trouvé très gentils et sympathique et on a bossé ensemble.
A quoi ressemblait votre direction musicale sur le film?
J'ai toujours travaillé avec les musiciens de la même manière, encore aujourd'hui. Comme à une femme à qui on dit « Tais-toi et sois belle! Tu joues comme je veux. Je conduis: un peu plus de saxophone là, un peu plus vite ici. Fais ça comme ci comme ça! C'est de la même façon que j'écris des livres, que je peint, que je réalise des films. En ayant des idées et en faisant ce que je veux.
Je suis un « amerloque » mais j'ai passé pas mal de temps ici en France. Je suis allé dans pas mal de pays mais je suis souvent à Paris, à New York et quelques fois à Los Angeles. Ce sont mes trois endroits habituels.
Vous avez entamé la réalisation de films après une discussion avec un passant, à l'époque où vous étiez conducteur de tramway à San Francisco. C'est vrai cette histoire ?
C'est presque ça. J'ai fais un roman avec des photos sur la vie de quelqu'un qui conduit les « Cable cars » à San Francisco. A un moment donné un monsieur est venu me voir sur mon « Cable car » pour que je lui dédicace mon livre (« The big heart » 1957 NDLR) et m'a dit: « Vous savez, votre bouquin c'est comme un film. » Cela m'a donné l'idée de passer derrière la caméra. C'est ainsi que j'ai commencé à faire des courts-métrages. Je suis allé à Los Angeles. Là bas on m'a dit: « Monsieur on ne prend pas des gens de couleur pour faire des films. » Du coup je suis parti en Hollande pour continuer mes études d'astronomie. Quand j'étais plus jeune j'étais pilote de bombardier pour l'US Air Force. J'ai vécu un peu aux Pays-Bas et puis j'ai reçu une invitation de la Cinémathèque française. Henri Langlois de la Cinémathèque avait vu mes petits films. Les américains me disaient que ça ne valait rien. Mais pour la Cinémathèque j'étais un génie! Alors j'ai dis: « Bien sûr je suis d'accord avec vous! Je suis un génie! » C'est de cette façon que je me suis retrouvé en France en 1959.
De quoi parlent ces courts-métrages comme « Three pick up men for Herrick » réalisé en 1957 ?
Oula à mon âge je ne me souviens plus très bien de quoi ça parlait! Je me rappelle juste qu'il y a une séquence où des gens attendent dans un coin pour être engagés comme éboueurs à la journée. Quelque chose comme ça. J'ai aussi fait un court-métrage plus tard ici à Paris, en 1963, dans le quartier de Belleville: « Cinq cent balles » L'histoire d'un enfant qui essaie d'attraper un billet de cinq cent balles dans une grille d'égout.
Et puis en 1967 vous réalisez votre premier long-métrage, toujours en France adapté de votre propre roman: La Permission (The story of a three days pass)
Ce qui est amusant c'est que ce film a été choisi pour représenter la France au festival du film de San Francisco. Les gens du festival ne savaient pas que j'étais noir ni que j'étais d'origine américaine. Tout le monde était stupéfait! Mais ce film a vraiment enclenché ma carrière dans le cinéma. J'ai aussi écrit la musique de « La permission » J'avais là deux carrières qui commençaient en même temps: musique et cinéma.
« La permission » c'est une histoire d'amour entre une jeune française et un GI noir américain de passage à Paris. Qu'est ce qui vous a inspiré ce film?
Les histoires d'amour ça marche toujours... à l'écran. Quand j'étais en France il y avait des bases américaines. Je me suis dis que c'était un sujet intéressant à exploiter. Le mélange de tout ça.
Là où nous sommes, du côté de Pigalle, j'aperçois un exemplaire d'Hara-Kiri, journal dans lequel vous avez écrit. Racontez-moi votre expérience de journaliste.
J'étais dans le 14ème arrondissement de Paris et j'avais lu une histoire de meurtre dans le journal. Je ne croyais pas à l'histoire qui était publiée. Je me suis pointé au journal: France observateur (l'ancêtre du Nouvel observateur NDLR) C'était au mois d'août. Tous les « vrais journalistes » étaient partis en vacances. J'ai eu de la chance. Comme il n'y avait personne je me suis retrouvé à faire le reporter pour ce journal. Et puis j'ai entendu parler d'un nouveau journal de « conneries » qui s'appelait Hara-Kiri. C'est comme ça que je suis allé là bas et que j'ai travaillé avec Topor, Gébé, Wolinski, Cavanna (prononcé Cavanaugh avec l'accent américain) toute cette bande là. Je faisais des traductions de « Mad « (magazine satirique américain créé par William Gaines et Harvey Kurtzman en 1952 NDLR) pour Hara-Kiri, des choses comme ça.
Comment étiez-vous perçu en tant que noir américain dans la France des années 60 ?
Je ne me considérais pas comme un touriste ou un expatrié américain. J'avais la vie de monsieur, madame, du quidam français. Très souvent les américains faisaient comme ça. Au commencement j'étais clochard devant le Café Deux Magots, le Café de Flore... Petit à petit j'ai appris l'argot, avec d'autres clodos. Je chantais dans la rue pour gagner un peu d'argent. J'ai vraiment été baigné dans la façon dont vit un français pauvre à Paris.
En 1970, fort de « La permission » vous arrivez avec un film à plus gros budget, tourné aux Etats-Unis: « Watermelon man » L'histoire d'un agent d'assurances blanc qui se réveille un matin dans la peau d'un noir.
C'est le seul film que j'ai fait pour un grand studio: Columbia films. J'ai fait ce film pour gagner le pognon et la notoriété afin de faire une oeuvre indépendante. Avec les bénéfices de ce film commercial j'ai pu faire mon chouchou: « Sweetback »
Justement, « Sweet Sweetback's baadassss song », sorti un an après, c'est le premier film de la « Blaxploitation ». Comment a débuté cette aventure?
C'est le mot juste: aventure. Ce film s'est fait dix ans après que j'ai été viré des studios californiens où j'avais réalisé mes premiers-courts métrages. Il n'y avait toujours pas de gens de couleur au cinéma. Il y avait quelquefois des acteurs mais pas de scénaristes ou de réalisateurs noirs. Et bien moi j'ai fais les trois! Les types des studios me disaient: « Ta gueule », ne me prenaient pas au sérieux. Une fois que le film est sorti, ça a fait plus de pognon qu'aucun film indépendant auparavant! Et là je suis devenu subitement un grand héros pour ces types. On m'appelle le père de la Blaxploitation parce que quand j'ai fais le fric de « Sweetback », les gars des studios ont fait des films « soit-disant noirs ».
Les film qui ont suivi le succès de Sweetback: « Shaft », « Foxy Brown », « Black Caesar » etc ce sont des films « récupérés » par les major companies, pour vous?
Les studios m'ont mis à l'écart dès le début. « Sweetback », quand on le regarde attentivement c'est un film politique. Alors que les personnages noirs dans les films suivants sont des « bénis-oui oui ». Ils ont noyé le poisson dans ces films. Quand on regarde « Shaft » et les autres, on s'aperçoit qu'au dessus des réalisateurs ou acteurs noirs, il y a toujours un blanc qui les dirige. Mais pas chez moi! « Sweetback » est un film militant. Les « Black panthers » à la sortie, ont demandé que chaque membre des « Panthers » aillent voir le film.
Vous avez dû emprunter à l'acteur et showman Bill Cosby pour vous aider à financer le film?
Il est intervenu plus tard dans le processus. Cosby a été très charmant avec moi. Il est venu sur le tournage. J'avais besoin de fric pour terminé le film. Il m'a aidé. Comme j'avais travaillé pour lui une fois je lui ai demandé de me donner un coup de main. C'est ce qu'il a fait. J'ai remboursé ce qu'il m'a prêté et tout le reste je l'ai payé de ma poche.
Etre considéré comme le père des films « Blaxploitation » vous le voyez comment avec le recul?
Ce n'est pas uniquement un film « Blaxploitation ». Ce film a aussi fait beaucoup pour le cinéma indépendant. Cela ne s'était jamais vu avant un film indépendant qui fait autant de fric que le mien! Avant ce film les oeuvres indépendantes n'étaient pas mises dans le circuit d'exploitation. N'oubliez pas que ce fameux « Sweetback » il n'y avait que deux salles, je dis bien deux salles, même pas deux villes, dans tous les Etats-Unis, qui étaient d'accord pour le montrer! Comme le film a super bien marché dans ces deux salles, à ce moment là les faux culs m'ont appelé: « Oh Melvin! Melvin! » A part le prêt de Bill Cosby à la fin, j'ai vraiment tout produit. Et comme je n'avais pas assez d'argent pour payer des vrais musiciens c'est moi qui ai composé la musique du film. J'ai pris un groupe pour les jouer... c'était « Earth wind and fire ». Et c'était le premier album de leur vie!
Earth Wind and fire, groupe mythique de Chicago en étaient à leurs premiers pas. Comment les avez vous rencontrés?
Ma secrétaire de l'époque Priscilla était très proche de l'un des musiciens. Elle m'a demandé si j'étais d'accord d'écouter son Jules et son groupe. C'était un pur hasard. Je ne connaissait pas Earth Wind and fire. Je les ai trouvé très gentils et sympathique et on a bossé ensemble.
A quoi ressemblait votre direction musicale sur le film?
J'ai toujours travaillé avec les musiciens de la même manière, encore aujourd'hui. Comme à une femme à qui on dit « Tais-toi et sois belle! Tu joues comme je veux. Je conduis: un peu plus de saxophone là, un peu plus vite ici. Fais ça comme ci comme ça! C'est de la même façon que j'écris des livres, que je peint, que je réalise des films. En ayant des idées et en faisant ce que je veux.
Vous êtes chanteur, pianiste, sur de plusieurs opus « spoken word » groovy comme: « Brer soul », « Don't play us cheap » ou « What the fuck you mean I can sing » Comment composez-vous?
J'écris mes musiques. Parler d'écriture est peut-être un peu trop dire. Je ne savais pas écrire la musique dans une forme classique. Mais ce n'était pas la mer à boire pour moi de faire des airs au piano et de les reproduire pour des films ou des disques. Cela marche et c'est ça qui compte! J'ai été un des premiers à faire du rap. Au début en entendant ça les gens pensaient que j'étais fou!
Vous avez participé au fameux festival de Wattstax, au Watt Stadium de Los Angeles, en 1972, avec entre autres: Isaac Hayes Richard Pryor, les Bar-Kays, Rufus Thomas, les Staples singers... Comment vous êtes vous retrouvé avec la crème du label Stax?
Les gens de Stax ont été très gentils avec moi. Ce sont eux qui ont sorti l'album de « Sweetback » J'étais sur un autre label avant: « A and M records » Les personnes de Stax cherchaient quelqu'un pour s'occuper de la foule, pour ne pas qu'il y ait de débordements de bagarres entre gangs, pendant le festival. Et comme ils ont été réglo avec moi j'ai accepté. J'étais en quelques sortes un « bodyguard », le videur de boîte de nuit de Wattstax!
Votre fils l'acteur-réalisateur Mario Van Peebles (qui se fait dépuceler enfant dans une maison close au début de « Sweetback » NDLR) a fait carrière avec des films comme « Panther » ou « New Jack city ». Comment jugez vous l'évolution de l'image des noirs dans le cinéma américain?
Quand mon fils a fait ses films c'était quinze ans après la vague « Blaxploitation ». La représentation des noirs au cinéma était devenue un peu plus réelle et leur image plus réaliste que dans tous les films qui ont suivi le succès de « Sweetback » Il y a eu quelques progrès.
Pour revenir sur la France vous jouez un petit rôle dans le film de Pascal Légitimus: « Antilles-sur-Seine. » Pouvez -vous en parler?
Pascal était gentil comme tout. Légitimus a joué dans une adaptation française de ma comédie musicale: « Don't play us cheap ». J'ai fais la connaissance de sa grand-mère Darling Légitimus, (héroïne du film « Rue-Cases nègres » d'Euzhan Palcy NDLR) de son oncle Théo Légitimus, sa tante, sa mère... C'était formidable d'avoir ce petit rôle dans ce film fait « en famille »
Quel est votre rapport à l'Afrique?
Je n'y connais pas grand chose. Je suis allé en Afrique du Sud, au Sénégal, au Kenya.. Je m'y sens bien mais j'ignore cette culture.
.
Comment avez vous intégré le festival « Sons d'hiver » il y a deux ans?
L'année d'avant, pour « Black revolution » un orchestre m'a demandé d'utiliser ma musique de « Sweetback ». Je leur ai dit que je préférais le faire moi-même avec eux. J'ai toujours envisagé « Sweetback » comme un opéra et cette rencontre musicale m'a permis de jouer la musique du film comme tel. Tout le monde à « Sons d'hiver » a été si adorable avec moi que j'ai décidé de revenir cette année mais cette fois avec mon propre groupe: Laxatif! Tu sais ce que c'est laxatif? On parle souvent de merde entre nous donc le nom est resté!
Pour finir quel style musical avez-vous joué avec ce: « Laxative band » à « Sons d'hiver »?
Je n'en sais rien! Un jour quelqu'un m'a dit « Melvin c'est du rap que tu fais ou alors du jazz? » Je ne sais pas ce que c'est et je m'en fous!
(1)Brer c'est la contraction de brother dans les codes des noirs américains.
J'écris mes musiques. Parler d'écriture est peut-être un peu trop dire. Je ne savais pas écrire la musique dans une forme classique. Mais ce n'était pas la mer à boire pour moi de faire des airs au piano et de les reproduire pour des films ou des disques. Cela marche et c'est ça qui compte! J'ai été un des premiers à faire du rap. Au début en entendant ça les gens pensaient que j'étais fou!
Vous avez participé au fameux festival de Wattstax, au Watt Stadium de Los Angeles, en 1972, avec entre autres: Isaac Hayes Richard Pryor, les Bar-Kays, Rufus Thomas, les Staples singers... Comment vous êtes vous retrouvé avec la crème du label Stax?
Les gens de Stax ont été très gentils avec moi. Ce sont eux qui ont sorti l'album de « Sweetback » J'étais sur un autre label avant: « A and M records » Les personnes de Stax cherchaient quelqu'un pour s'occuper de la foule, pour ne pas qu'il y ait de débordements de bagarres entre gangs, pendant le festival. Et comme ils ont été réglo avec moi j'ai accepté. J'étais en quelques sortes un « bodyguard », le videur de boîte de nuit de Wattstax!
Votre fils l'acteur-réalisateur Mario Van Peebles (qui se fait dépuceler enfant dans une maison close au début de « Sweetback » NDLR) a fait carrière avec des films comme « Panther » ou « New Jack city ». Comment jugez vous l'évolution de l'image des noirs dans le cinéma américain?
Quand mon fils a fait ses films c'était quinze ans après la vague « Blaxploitation ». La représentation des noirs au cinéma était devenue un peu plus réelle et leur image plus réaliste que dans tous les films qui ont suivi le succès de « Sweetback » Il y a eu quelques progrès.
Pour revenir sur la France vous jouez un petit rôle dans le film de Pascal Légitimus: « Antilles-sur-Seine. » Pouvez -vous en parler?
Pascal était gentil comme tout. Légitimus a joué dans une adaptation française de ma comédie musicale: « Don't play us cheap ». J'ai fais la connaissance de sa grand-mère Darling Légitimus, (héroïne du film « Rue-Cases nègres » d'Euzhan Palcy NDLR) de son oncle Théo Légitimus, sa tante, sa mère... C'était formidable d'avoir ce petit rôle dans ce film fait « en famille »
Quel est votre rapport à l'Afrique?
Je n'y connais pas grand chose. Je suis allé en Afrique du Sud, au Sénégal, au Kenya.. Je m'y sens bien mais j'ignore cette culture.
.
Comment avez vous intégré le festival « Sons d'hiver » il y a deux ans?
L'année d'avant, pour « Black revolution » un orchestre m'a demandé d'utiliser ma musique de « Sweetback ». Je leur ai dit que je préférais le faire moi-même avec eux. J'ai toujours envisagé « Sweetback » comme un opéra et cette rencontre musicale m'a permis de jouer la musique du film comme tel. Tout le monde à « Sons d'hiver » a été si adorable avec moi que j'ai décidé de revenir cette année mais cette fois avec mon propre groupe: Laxatif! Tu sais ce que c'est laxatif? On parle souvent de merde entre nous donc le nom est resté!
Pour finir quel style musical avez-vous joué avec ce: « Laxative band » à « Sons d'hiver »?
Je n'en sais rien! Un jour quelqu'un m'a dit « Melvin c'est du rap que tu fais ou alors du jazz? » Je ne sais pas ce que c'est et je m'en fous!
(1)Brer c'est la contraction de brother dans les codes des noirs américains.

Discographie sélective:
- Brer soul (1969) réédité chez Cherry red records
- Watermelon man OST (1970)
- Sweet sweetback's baadassss song OST (1971)
- What the fuck you mean I can't sing (1974)
Filmographie sélective:
- Cinq cent balles Court-métrage 1963
- La permission (The story of a three day pass) 1967
- Sweet sweetback's badaassss song 1971
- Don't play us cheap 1973
- Le conte du ventre plein (Bellyfull) 2000
- Confessionsofa Ex-Doofus Itchy Footed Mutha (2008)
Mark Daniels: Classified X (1998) documentaire sur Mevin Van Peebles
Bibliographie:
- The big heart (1957)
- Le chinois du XIV (1966)
- La fête à Harlem (1967)
- La permission (1967)
- Sweet sweetback badaassss song (1971)
- Panther (1995)
Liens
- Reportage MAGAZINE - Melvin VAN PEEBLES - USA (Africa 24)
- Melvin Van Peebles revient sur ses mille et une vies : http://www.poptronics.fr/Melvin-Van-Peebles-revient-sur-ses





 Les mille vies de Melvin
Les mille vies de Melvin